Thiers et Arcachon
 Thiers
fait partie de ces quelques vieillards auxquels les Français
se sont donnés en un siècle quand tout allait
mal, pour le meilleur ou pour le pire: après lui,
il y aura Georges Cémenceau pendant la 1ère
guerre mondiale, le maréchal Philippe Pétain
pendant la seconde, le général Charles de
Gaulle en 1958.
Thiers
fait partie de ces quelques vieillards auxquels les Français
se sont donnés en un siècle quand tout allait
mal, pour le meilleur ou pour le pire: après lui,
il y aura Georges Cémenceau pendant la 1ère
guerre mondiale, le maréchal Philippe Pétain
pendant la seconde, le général Charles de
Gaulle en 1958.Thiers a dominé la vie politique française du XIXème siècle; il sera Premier ministre du roi des Français, Louis Philippe, chef de l'opposition à l'empereur Napoléon III et élu "chef du pouvoir exécutif" après la défaite de Sedan et la chute de l'empire pendant la guerre contre les Prussiens. Il a alors 73 ans et il va en quelques semaines conquérir et ses titres de gloire de "libérateur du territoire" et ses titres d'infamie de "fusilleur" de la Commune.
Son plus fidèle ennemi politique Léon Gambetta lui reconnaîtra ce titre de "libérateur du territoire" pour avoir su négocier tambour battant avec les Prussiens et faire ratifier un traité de paix. Ce monarchiste convaincu est aussi un pragmatique et il ralliera la république quand il verra que c'est le seul régime possible. Mais il ralliera la républqiue conservatrice, celle de la révolution bourgeoise de 1789, pas celle de la terreur de 1792.
Il va d'ailleurs porter un coup terrible au mouvement ouvrier français dans l'impitoyable répression qu'il ordonnera après la victoire sur la Commune: 20.000 fusillés, 38.000 arrestations, 10.000 déportations dont celle de Louise Michel. Le mouvement ouvrier français est décapité pour 50 ans.
Toutes les villes de droite en France ont une place, une rue, une avenue Thiers, rendant hommage au grand homme, si petit par la taille (1,55 mètre). Arcachon a fait mieux, donnant le nom du premier président de la 3ème république à la place centrale du front de mer ET à la grande jetée promenade construite en 1903.
Vous allez pouvoir lire le discours qu'a
prononcé Thiers en 1875 à Arcachon devant
les notables de la région. Ils se connaissent bien:
il n'y a pas si longtemps, le gouvernement présidé
par Thiers était réfugié à
Bordeaux pour fuir la pression des Prussiens sur Paris.
Thiers n'est plus que député, mais c'est
un personnage considérable dans la République
qui vient d'être définitivement installée
en France au détour d'un amendement à l'Assemblée
nationale. Il a traversé le siècle, il a
78 ans; dans deux ans, la France lui fera des funérailles
nationales, six ans seulement après le drame
de la Commune: même en "villégiature"
à Arcachon, il a quelque chose à dire. Ce
n'est pas encore son testament, mais on sent que l'homme
a besoin de justifier une fois encore la politique qu'il
a suivie; il donne aussi sa vision de l'avenir de la France
et de l'Europe et il dit sa conviction que "la France
(est) indispensable à l'équilibre européen".
La visite d'un si important personnage dans une (encore) si petite ville ne pouvait pas manquer de susciter une passe d'armes dans la guerre des deux A, Alphonse Lamarque de Plaisance et Adalbert Deganne, dont la haine qu'ils se vouaient n'avait d'égal que leur volonté de développer leur ville. Ils seront tour à tour maires de la ville.
Quand l'ancien président vient séjourner à Arcachon, c'est Lamarque qui est maire. Je laisse M. et Mme François Cottin vous raconter la suite:
"Thiers séjournait alors au Grand Hôtel à titre privé. La municipalité Lamarque de Plaisance n'osa pas recevoir officiellement l'ancien Président. Deganne, trop content de pouvoir contrer son éternel rival, prit alors l'initiative d'une réception "privée", en son chateau où il convia plus de quatre cents invités, notables et élus "républicains", députés, conseillers municipaux et généraux "
M. et Mme Cottin, grands spécialistes de l'histoire du bassin, rapporte également cette anecdote :
"Edouard Manet séjourna un mois à Arcachon, en mars 1871 (au tout début de la Commune). Il se rendit à Bordeaux, où le gouvernement siegeait alors, et il put assister à quelques séances de la Chambre des Députés , qui se réunissait au grand Théâtre. "La semaine dernière je suis allé à Bordeaux. Balleroy m'a fait entrer à la Chambre. Je ne pensais pas que la France puisse se faire représenter par des gens aussi gâteux, sans excepter ce petit Thiers, qui j'espère va crever un jour à la tribune, et nous débarrasser de sa vieille petite personne ", écrit l'artiste dans une lettre à Bracquemond (Arcachon, 18 mars).
Nos ancêtres avaient la méchanceté
naturelle.... et des estomacs blindés :
Avant
de lire le discours, je vous invite à jeter un
oeil sur le menu de ce banquet offert par Deganne en
cliquant sur le carton ci-dessous: j'espère pour
lui que Thiers a parlé en début de repas,
sinon il risque fort de n'avoir parlé pour rien...

Cliquez sur le carton pour voir le menu
(Carton et menu m'ont été envoyés par les Cottin. Merci à eux)
DISCOURS PRONONCÉ A ARCACHON LE 17 OCTOBRE 1875
Les lois constitutionnelles affirmant en France le maintien
du régime républicain venaient d'être
votées. Partout on se préparait aux élections
sénatoriales et législatives qui devaient
avoir prochainement lieu, et, profitant de quelques semaines
de vacances prises par l'Assemblée nationale avant
sa séparation définitive, M. Thiers était
allé s'établir à Arcachon avec sa
famille. A l'occasion du séjour qu'il fit dans
cette localité, les députés républicains
du département de la Gironde, le bureau du conseil
général, la commission départementale,
le Conseil d'arrondissement de Bordeaux, la municipalité
de cette ville, une délégation de celle
de Tonneins, et, enfin, nombre de notabilités républicaines
du pays, résolurent d'aller lui rendre leurs devoirs
et chargèrent M. Fourcand, ancien maire de Bordeaux,
d'être l'interprète des sentiments qui les
animaient tous. Dans l'allocution qu'il prononça
à cet effet, M. Fourcand rappela d'abord les principaux
actes accomplis par M. Thiers durant les deux années
qu'il avait passées à la tête des
affaires, exprima l'espoir que la politique d'ordre et
d'apaisement dont il s'était fait le promoteur
recevrait sa prochaine consécration, et termina
en exprimant aussi la confiance que la Constitution du
25 février ne tarderait pas à recevoir une
loyale exécution.
M.
Thiers fit la réponse suivante.
Messieurs,
Je vous remercie bien sincèrement de la démarche
que vous faites aujourd'hui auprès de moi, et qui
me touche profondément par les souvenirs qu'elle
me rappelle. C'est au milieu de vous, en effet, que j'ai
passé les quatre mois affreux de nos malheurs.
Vous m'avez vu tous les jours, consterné, désolé
comme vous l'étiez tous, des bruits de nos désastres,
qui se succédaient sans interruption, et me demandant
avec désespoir comment on pourrait y mettre un
terme. Tout à coup, dans cette situation qui semblait  sans remède, je me suis trouvé accablé
du fardeau du pouvoir, qui n'était certes pas enviable,
mais que je ne pouvais pas refuser non plus ; et vous
avez vu de vos propres yeux les efforts que je faisais
pour tenir tête à la mauvaise fortune de
la France ! Vous êtes donc mes témoins devant
elle, mes témoins devant l'histoire, et je vous
remercie de venir en ce jour m'apporter votre sincère
et loyal témoignage.
sans remède, je me suis trouvé accablé
du fardeau du pouvoir, qui n'était certes pas enviable,
mais que je ne pouvais pas refuser non plus ; et vous
avez vu de vos propres yeux les efforts que je faisais
pour tenir tête à la mauvaise fortune de
la France ! Vous êtes donc mes témoins devant
elle, mes témoins devant l'histoire, et je vous
remercie de venir en ce jour m'apporter votre sincère
et loyal témoignage.
Vous avez tout vu, Messieurs : pas une armée ;
et, si j'en avais possédé une, pas de ressources
pour la payer ; 200,000 ennemis devant Paris, autant en
Champagne et en Bourgogne, 150,000 à Tours, menaçant
Bordeaux, 150,000 à Bourges, menaçant Lyon;
tous les partis debout, prêts à en venir
aux mains ; les villes du Midi, liguées pour la
république, Paris livré à la Commune,
et, pour former un gouvernement qui surmontât ces
difficultés, la défiance universelle des
esprits prêts à refuser leur concours au
gouvernement qui ne répondrait pas à leurs
passions !
Dans cette situation, dont le souvenir, quand j'y pense,
m'émeut profondément, ai-je hésité?
Non. Je ne me suis pas demandé si je réussirais,
je n'ai songé qu'à mon devoir, qui n'était
pas de réussir, mais de me dévouer. Je n'ai
pas plus pensé à la monarchie qu'à
la république, j'ai accepté le pouvoir sous
la forme qu'on lui a donnée et tel que les événements
l'avaient fait, résolu à rendre le dépôt
tel qu'on me l'avait confié. Conclure la paix,
la faire la moins cruelle possible, rétablir l'ordre,
les finances, l'armée, et, si je le pouvais, en
payant la rançon du pays, le délivrer de
la présence de l'étranger, telle était
la tâche à remplir, la seule dont je me sois
occupé et que j'aie annoncée au pays. Avec
l'aide de la France elle-même, qui ne s'est point
abandonnée, avec l'aide de Dieu, qui a été
clément pour nous, les premières difficultés
ont été surmontées, nous avons vu
un peu d'ordre se rétablir, et nous nous sommes
trouvés aux portes de Paris.
profondément, ai-je hésité?
Non. Je ne me suis pas demandé si je réussirais,
je n'ai songé qu'à mon devoir, qui n'était
pas de réussir, mais de me dévouer. Je n'ai
pas plus pensé à la monarchie qu'à
la république, j'ai accepté le pouvoir sous
la forme qu'on lui a donnée et tel que les événements
l'avaient fait, résolu à rendre le dépôt
tel qu'on me l'avait confié. Conclure la paix,
la faire la moins cruelle possible, rétablir l'ordre,
les finances, l'armée, et, si je le pouvais, en
payant la rançon du pays, le délivrer de
la présence de l'étranger, telle était
la tâche à remplir, la seule dont je me sois
occupé et que j'aie annoncée au pays. Avec
l'aide de la France elle-même, qui ne s'est point
abandonnée, avec l'aide de Dieu, qui a été
clément pour nous, les premières difficultés
ont été surmontées, nous avons vu
un peu d'ordre se rétablir, et nous nous sommes
trouvés aux portes de Paris.
J'avais pu, avec les restes de nos défaites, réunir
une force militaire de 150,000 hommes, et, si c'était
assez pour essayer d'arracher Paris à la Commune,
ce n'était pas assez pour contenir toutes les grandes
villes de France, profondément inquiètes
pour le maintien de la république, et venant nous
demander avec défiance et irritation si c'était
pour la monarchie que nous combattions.
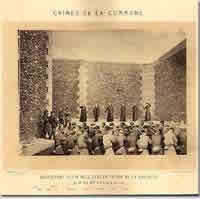 Non,
non, leur ai-je dit, c'est pour l'ordre, l'ordre seul,
et, agissant au grand jour, j'ai porté à
la tribune la réponse que j'avais faite : personne
ne m'a démenti ; tout le monde, au contraire, a
voté l'ordre du jour que je demandais. Paris a
été arraché à la Commune,
les assassins des otages ont été punis au
nom des lois, et par les lois seules, et la France a respiré
!
Non,
non, leur ai-je dit, c'est pour l'ordre, l'ordre seul,
et, agissant au grand jour, j'ai porté à
la tribune la réponse que j'avais faite : personne
ne m'a démenti ; tout le monde, au contraire, a
voté l'ordre du jour que je demandais. Paris a
été arraché à la Commune,
les assassins des otages ont été punis au
nom des lois, et par les lois seules, et la France a respiré
!
Ce jour-là, m'a-t-on dit quelquefois, vous pouviez
tout. Hélas ! non. La moitié de ma tâche
était à peine accomplie; l'ennemi occupait
les forts de Paris et dévorait nos campagnes, de
la Seine à la Meuse ; d'affreux conflits pouvaient
tous les jours éclater et rallumer la guerre; et
enfin, pour retirer une à une nos provinces  des
mains de nos vainqueurs, il fallait des milliards, et,
pour avoir des milliards, il fallait rétablir le
Crédit. Eh bien, le crédit, je l'ai demandé
à la politique d'apaisement. Croyez-vous que si,
me démentant audacieusement le lendemain du jour
où j'avais déclaré que nous combattions
pour l'ordre et non pour la monarchie, j'avais essayé
de la relever, j'aurais obtenu l'apaisement des esprits,
sans lequel toute opération financière était
impossible? Non, assurément; au contraire, en restant
fidèle à la parole donnée devant
l'Assemblée nationale, les hommes d'ordre étant
rassurés par la destruction de la Commune, les
républicains devenus confiants parce qu'on ne les
avait pas trompés, un calme inattendu et qui a
étonné l'Europe s'est produit tout à
coup : j'avais besoin de six milliards, on m'en a offert
plus de quarante, et j'ai pu, en deux ans, reprendre un
à un nos départements occupés, libérer
le territoire et rendre la France à elle-même.
des
mains de nos vainqueurs, il fallait des milliards, et,
pour avoir des milliards, il fallait rétablir le
Crédit. Eh bien, le crédit, je l'ai demandé
à la politique d'apaisement. Croyez-vous que si,
me démentant audacieusement le lendemain du jour
où j'avais déclaré que nous combattions
pour l'ordre et non pour la monarchie, j'avais essayé
de la relever, j'aurais obtenu l'apaisement des esprits,
sans lequel toute opération financière était
impossible? Non, assurément; au contraire, en restant
fidèle à la parole donnée devant
l'Assemblée nationale, les hommes d'ordre étant
rassurés par la destruction de la Commune, les
républicains devenus confiants parce qu'on ne les
avait pas trompés, un calme inattendu et qui a
étonné l'Europe s'est produit tout à
coup : j'avais besoin de six milliards, on m'en a offert
plus de quarante, et j'ai pu, en deux ans, reprendre un
à un nos départements occupés, libérer
le territoire et rendre la France à elle-même.

Voilà
les faits, Messieurs, et, si je vous les rappelle, ce
n'est pas pour faire ressortir la part que j'ai pu y prendre
; non, le pays lui-même "veut bien me les rappeler
tous les jours, sans que je vienne moi-même réveiller
sa généreuse mémoire. Ces faits,
je vous les rappelle pour en tirer l'enseignement dont
nous avons besoin, et qui doit décider de la conduite
que nous avons à tenir pour notre salut définitif.
A Bordeaux, à Paris, avant et après la Commune,
y a-t-il eu un jour, un seul, où nous ayons pu
songer à rétablir la monarchie ?... A Bordeaux,
il eût été fou et coupable d'y songer,
quand aucune des choses urgentes qui étaient à
faire n'était seulement entreprise ; sous les murs
de Paris,  c'eût été la plus souveraine
des imprudences; le lendemain, le plus audacieux des manques
de parole, et le contraire, surtout, de cette politique
d'apaisement qui seule a libéré le territoire
et rouvert la carrière de l'industrie, du commerce,
de l'économie, complètement fermée
pour nous.
c'eût été la plus souveraine
des imprudences; le lendemain, le plus audacieux des manques
de parole, et le contraire, surtout, de cette politique
d'apaisement qui seule a libéré le territoire
et rouvert la carrière de l'industrie, du commerce,
de l'économie, complètement fermée
pour nous.
Un jour devait venir cependant où la question de
la forme du gouvernement se poserait devant le pays naturellement
et nécessairement. La France était délivrée
de la présence de l'étranger, et ce "
noble blessé, " comme je l'avais qualifiée,
ayant recouvré ses forces et la liberté
de ses esprits, tous les partis à la fois ont demandé
qu'il fût pourvu à la Constitution du pays.
A ce moment, Messieurs, ai-je pris sur moi de soulever
cette redoutable question ? Non, j'en connaissais la gravité;
je me suis borné à signaler l'état
de l'opinion, en laissant, bien entendu, à l'Assemblée
nationale le soin de prononcer ; car, je me hâte
de le dire, j'aurais pu décider la question à
moi seul que je ne l'aurais pas fait. D'une monarchie
de douze siècles, moi, humble citoyen, vouloir
faire une république, une république à
destinée inconnue! Non, non; j'aurais été,
ce que je n'étais pas, tout-puissant, disposant
d'armées victorieuses, que j'aurais regardé
comme une impiété de me substituer à
la nation! Je n'étais, je ne pouvais être
que son dévoué serviteur, et je me suis
borné à mettre sous ses yeux la question
que je n'avais pas soulevée et que la Providence
avait seule placée devant nous. Mais, en la présentant
avec ma franchise naturelle, j'ai laissé voir mon
opinion personnelle, et alors l'Assemblée nationale,
usant de son droit, s'est séparée de moi.
serviteur, et je me suis
borné à mettre sous ses yeux la question
que je n'avais pas soulevée et que la Providence
avait seule placée devant nous. Mais, en la présentant
avec ma franchise naturelle, j'ai laissé voir mon
opinion personnelle, et alors l'Assemblée nationale,
usant de son droit, s'est séparée de moi.
Loin de m'en plaindre, je l'en remercie. Ma tâche
la plus indiquée était achevée, les
choses incontestablement bonnes, telles que le rétablissement
de l'ordre et du crédit, la libération du
territoire, étaient accomplies, et il ne restait
que la tâche ingrate, impossible, de satisfaire
les partis, voulant chacun le contraire de ce que voulaient
les autres. Sans doute, j'aurais pu légalement
retenir le pouvoir, à une condition toutefois:
c'était de changer le ministère en appelant
des hommes qui croyaient la monarchie désirable
et surtout possible. Je n'ai cru ni digne d'un bon citoyen,
ni utile pour le pays, d'agir de la sorte. Le pouvoir
m'étant redemandé, je l'ai remis à
l'instant même, sans hésitation, sans regrets.
Peut-être aurais-je pu opérer quelque bien
encore; mais il y avait quelque chose de plus urgent :
c'était d'éclairer le pays, et de l'éclairer
complètement sur la possibilité de refaire
la monarchie. Pouvait-elle être rétablie?
Y avait-il à-propos, utilité, possibilité,
chance de durée, à l'essayer?
Il appartenait aux auteurs du 24 mai [ndlr: les monarchistes]
de faire sortir cette vérité des obscurités
de la situation. Moi présent au pouvoir, il serait
resté aux partis le prétexte de ma mauvaise
volonté. Les hommes du 24 mai au pouvoir, toute
fausse interprétation devenait impossible. C'était
à eux à faire la lumière, et, je
crois pouvoir l'affirmer, ils l'ont faite éclatante,
irrésistible.
En effet, eux présents au pouvoir et le sachant,
ne l'empêchant pas, on est allé à
Frohsdorf [résidence du comte de Chambord], et,
qu'on me permette de le dire, sans se soucier beaucoup
des lois, on est allé traiter de la couronne
de France !
Loin de blâmer mes successeurs de leur attitude
en cette occasion, je trouve bon qu'ils aient ainsi laissé
tout faire, tout tenter; mais, alors, il faut bien m'accorder
que la preuve est complète, sans que rien y manque,
et je me borne à cette question : " La monarchie
a-t-elle été rétablie"? "
 A
cette simple question, j'entends la voix des partis
: C'est la faute de M. le comte de Chambord! disent
quelques-uns. Loin de moi, Messieurs, l'inconvenance
de blâmer
M. le comte de Chambord, et l'inconvenance tout aussi
grande de le défendre. Je crois être plus
respectueux en ne le jugeant pas; mais ses amis répondent
pour lui à ceux qui l'accusent : C'est votre faute,
à vous, disent-ils, à vous qui avez voulu
faire des conditions au roi !
A
cette simple question, j'entends la voix des partis
: C'est la faute de M. le comte de Chambord! disent
quelques-uns. Loin de moi, Messieurs, l'inconvenance
de blâmer
M. le comte de Chambord, et l'inconvenance tout aussi
grande de le défendre. Je crois être plus
respectueux en ne le jugeant pas; mais ses amis répondent
pour lui à ceux qui l'accusent : C'est votre faute,
à vous, disent-ils, à vous qui avez voulu
faire des conditions au roi !
Je ne juge, je le répète, ni les uns ni
les autres : mais la monarchie sans conditions n'a pas
été faite. Restait la monarchie à
conditions, et elle avait ses représentants naturels
dans les princes d'Orléans. Dieu me garde de les
juger eux aussi! J'ai loyalement servi leur auguste père,
et je n'aurai jamais pour eux que les affectueux respects
que je leur dois. Mais, on le sait, ces princes avaient
déposé aux pieds de M. le comte de Chambord
l'engagement de s'abstenir de toute prétention.
Dès lors, la maison de Bourbon était hors
de cause. Restait le jeune successeur des Napoléons,
achevant son éducation et chargé de la mémoire
encore toute fraîche de nos désastres. Aussi,
Messieurs, après avoir échoué à
Frohsdorf, personne n'a essayé de réussir
ailleurs ; et, pendant près de deux années,
nous avons eu sous les yeux le spectacle monotone et triste
de l'impuissance des partis, s'accusant les uns les autres
d'être impossibles, s'observant toutefois d'un œil
jaloux, toujours prêts à s'unir contre celui
qui semblait avoir un avantage d'un moment sur les autres,
et. n'hésitant pas à lui préférer
hautement la république.

C'est devant ce spectacle que l'Assemblée nationale, préférant, on peut le dire sans lui manquer de respect, préférant la monarchie, mais reconnaissant son impossibilité, a, dans un sentiment de sagesse, voté la république dans la journée du 25 février.
Eh bien, Messieurs, la république est votée ; que faut-il
faire? Je réponds sans hésiter : Une seule chose, et tous,
tout de suite, s'appliquer franchement, loyalement, à la faire réussir.
Quelque avenir qu'on puisse prévoir, il n'y a pas d'autre devoir
que celui-là.
Je vois bien des gens, impatients de pénétrer l'avenir et
oubliant la fable, imiter les anciens Grecs qui allaient consulter le Sphinx...
Vous le savez tous, l'animal, perfide, les écoutait sans répondre,
et, quand ils n'avaient pas deviné l'énigme, il les dévorait.
Ne recherchons pas un avenir inconnu, et consultons le devoir présent, évident,
indéniable. La république est votée, et, sous peine
d'être les plus inconséquents des hommes, il faut, je le répète,
la faire réussir.
Faire réussir la république, me dira-t-on, c'est bien difficile!
Oui, je le reconnais ; mais la monarchie, tombée trois fois en quarante
ans, est-elle donc plus facile? Sans doute il dépend des partis
monarchiques d'augmenter cette difficulté par leurs résistances,
leur opposition ouverte ou cachée; mais rendront-ils pour cela la
monarchie possible? Non ; les mêmes causes subsistent et subsisteront
longtemps, Supposez, par une odieuse prévision, que la maison de
Bourbon n'eût plus qu'un seul représentant; il resterait les
Napoléons, que nous pouvons voir voter certains jours avec les Bourbons,
mais que nous ne verrons jamais régner ensemble. Or c'est bien assez
de deux dynasties pour la guerre civile, sans qu'il en faille trois. La
rose blanche et la rose rouge y suffisent, et il n'est pas besoin d'en
imaginer une troisième.
En créant des difficultés à la république on
ne rendrait pas, je le répète, la monarchie plus facile :
on ne rendrait possible que le chaos, et, pour fin dernière, des
malheurs cette fois irréparables.
Aujourd'hui quelle est la situation véritable? La république
n'est plus une question de principe, mais une question d'application, et
c'est là que commencent non seulement nos devoirs à tous,
mais ceux du gouvernement lui-même.
Le pouvoir est resté aux. hommes du 24 mai ; non pas à tel
ou tel, mais aux principaux. On leur a laissé le pouvoir, et l'on
a bien fait. C'était la seule manière de les laisser sans
souci et sans prétexte fondé à l'égard du maintien
de l'ordre, qui était la grande objection faite à la république.
Ils l'ont conservé; mais c'est à eux à bien considérer
l'usage qu'ils en feront.
On me dira que c'est ce qui s'était passé à Bordeaux
lorsqu'on avait laissé la république dans les mains des monarchistes.
Cela est vrai; mais je prie de ne pas oublier que, parmi ces monarchistes,
il y avait trois ministres républicains très anciens, très
persistants, et que tous les autres ministres étaient pénétrés
de la nécessité de la république et agissaient tous
avec une parfaite unité d'intentions et de vues.
C'est aujourd'hui ce qu'il faut souhaiter et obtenir.
Je comprends qu'on soutienne qu'il faut des conservateurs au pouvoir. Je
l'admets, car, pour ma part, j'ai toujours été conservateur,
et ai toujours voulu le paraître autant que je l'étais.
Mais il faut s'entendre sur ce mot et prendre garde à l'interprétation
qu'on cherche à lui donner. Par exemple, on établit des
classes parmi les conservateurs, et puis ou dit : point de radicaux
d'abord. Soit, si par là on entend les partisans de certaines
théories économiques, financières et sociales,
que les radicaux professent et renonceraient bientôt à pratiquer
s'ils arrivaient au pouvoir. Mais on ne s'en tient pas là, et,
après avoir repoussé les radicaux en personne, on repousse
ceux qui, sans être radicaux, mèneraient à eux
par leur manière de faire : de sorte qu'il y a les radicaux
d'abord, dont il faut se défendre, puis ceux qui mèneraient
aux radicaux sans l'être ; puis enfin, par voie de conséquence,
ceux qui nous mèneraient aux complaisants des radicaux ; et,
en continuant ces classifications, il pourrait bien arriver qu'on n'admît
au service de la république que ceux qui n'ont jamais voulu
d'elle et qui n'en veulent pas même aujourd'hui.
Sans doute le pouvoir ne doit pas être une compétition de
places, une lutte d'ambitions ; mais cependant il faut faire servir un
gouvernement par ceux qui en ont toujours voulu, et, au moins en partie,
par ceux qui, n'en ayant pas voulu autrefois, en veulent aujourd'hui. Autrement,
qu'arriverait-il? On aurait des fonctionnaires, et, en parlant des fonctionnaires,
je n'entends pas cette partie modeste, laborieuse, infatigable, de l'administration,
qui a toujours servi admirablement la France ; qui, le lendemain de chaque
révolution, est toujours venue reprendre le cours des affaires,
les enseigner aux nouveaux venus qui les ignoraient, et a toujours maintenu
invariable la marche des services publics : je parle des fonctionnaires
politiques, changeant avec la politique et en étant la représentation
aux yeux des peuples. Eh bien, on aurait des fonctionnaires qui n'osent
pas prononcer le nom du gouvernement qu'ils servent, à qui, par
exemple, c'est un miracle d'arracher le mot de république ; qui
parlent de la France, nom sacré qui nous est cher à tous,
qu'il est toujours à propos de prononcer, mais qu'il ne faudrait
pas toujours prononcer uniquement, pour ne pas en prononcer un autre.
Ce n'est pas ainsi, Messieurs, qu'on rallie les populations incertaines,
soupçonneuses, et qu'on se fait suivre par elles dans les voies
où l'on marche, et qui sont les seules où vous puissiez marcher
désormais. On s'expose, en agissant de la sorte, à offrir
au pays un gouvernement incertain, tiraillé, énigmatique,
dans lequel on cherche, sans la trouver, la pensée qui le dirige.

Du reste, Messieurs, les élections approchent, et c'est à la
France qu'il appartient d'imprimer au gouvernement l'unité dont
il a absolument besoin ; que, se gardant de tout esprit d'exclusion, car
les gouvernements exclusifs sont stériles, la France, agissant avec
discernement, accueille tous les hommes qui ont su prendre leur parti,
et se garde de ceux qui, républicains le jour du scrutin, se hâteraient
le lendemain d'expliquer leur profession de foi par l'article de nos lois
constitutionnelles qui stipule la révision.
Qu'en abordant les urnes électorales la France n'oublie pas qu'elle
a son système financier à compléter, ses lois militaires à revoir,
car celles qu'on a faites ne sont pas toutes bonnes, ses traités
de commerce à renouveler en 1870, son enseignement à développer
d'après les bases de la société moderne ; et si, à toutes
ces difficultés de système, qui rendent les solutions si
laborieuses, venaient se joindre les difficultés naissant des divisions
des partis, lesquelles ont rendu tout si difficile dans l'Assemblée
actuelle, que la France n'oublie pas qu'elle n'aboutirait qu'au chaos dont
je vous parlais tout à. l'heure, et achèverait de perdre
sou temps devant l'Europe, qui ne perd pas le sien, car il n'y a pas une
nation qui ne s'occupe aujourd'hui de se rendre à la fois plus forte
et mieux ordonnée.
A ce mot de l'Europe, j'entends plus d'une voix me dire : Eh bien, quand
vous aurez fait tout cela, et même quand vous y aurez réussi,
vous resterez toujours seul, car jamais la république ne trouvera
d'alliés dans le monde. Permettez-moi, à ce sujet, quelques
mots encore, qui ne seront peut-être pas déplacés dans
ma bouche. Les partis font l'Europe chacun à son image ; et, je
leur en demande bien pardon, en la faisant à leur image, ils se
trompent souvent.
L'Europe aujourd'hui est parfaitement raisonnable, parce qu'elle est profondément éclairée.
Et pour sympathiser avec elle, savez-vous ce qu'il faut? Un gouvernement
raisonnable comme elle. Sans doute l'Europe n'a pas toujours été ce
qu'elle est dans le temps présent, mais, croyez-le bien, elle n'est
plus l'Europe de 1815, ni celle de 1830.
Alors, sur tous les trônes, dans tous les cabinets, il y avait des
princes et des ministres qui avaient combattu quarante ans la Révolution
française ; et tout à coup, en 1830, ils la virent sortir
du tombeau où on la croyait ensevelie à jamais, ils furent
profondément émus et troublés. J'ai vu ces temps,
ils ne sont jamais sortis de ma mémoire.
Il semblait à toutes les imaginations que l'affreux Robespierre,
que le grand et terrible Napoléon, allaient reparaître et
renverser tous les trônes. Ces vaines terreurs furent bientôt
dissipées ; mais la défiance, les rancunes, restèrent
; l'Europe se maintint armée et coalisée contre la France,
et, même après avoir évacué son territoire par
l'action efficace et patriotique de l'illustre duc de Richelieu, elle ne
cessa pas de se réunir presque tous les ans en congrès pour
veiller aux événements, et, au besoin, pour marcher sur la
France et y étouffer la Révolution qui, disait-on, menaçait
tous les gouvernements et toutes les sociétés.
Je vous le demande, y a-t-il rien de semblable aujourd'hui? Sans doute,
lorsqu'il se passe quelque chose de grave chez nous, on y regarde, car
la France n'a pas cessé d'être un objet de grande attention
; mais la pensée unanime de tous les gouvernements, c'est de respecter
scrupuleusement l'indépendance de la France, et de lui laisser à elle
seule le soin, de ses propres affaires.
Ainsi, il y a quarante ans, le principe de la politique européenne était
l'intervention, et maintenant, au contraire, la non-intervention est le
principe adopté dans tous les cabinets.
Telle est la différence capitale que l'oeil prévenu des partis
n'aperçoit pas, et la cause de cette différence, c'est, que
le temps a marché, son flambeau éclatant à la main.
On avait voulu maintenir par la force les dynasties qui régnaient
en France, en Espagne, à Naples, en Toscane, en Lombardie,et on
s'est bientôt convaincu que jamais des gouvernements durables ne
pourraient reposer sur l'influence étrangère. On a dès
lors reconnu qu'il fallait laisser chaque nation faire son sort elle-même
; et, en ce moment, cette conviction est poussée si loin, que si,
comme en Herzégovine, par exemple, il éclate quelque trouble,
la première pensée est de ne pas s'en mêler, la seconde
de ne pas chercher à en profiter par respect pour le repos général,
la troisième enfin de conseiller aux peuples la soumission, et à leurs
souverains les réformes commandées par le temps et l'humanité.
Et ces sages princes européens qui conseillent ainsi les réformes
aux princes orientaux n'ont vraiment pas mauvaise grâce à le
faire, car tous se sont montrés dans leur pays de grands et, sages
réformateurs dont l'histoire proclamera les bienfaits.
Cherchez, en effet, regardez sur tous les trônes de l'Europe, et
vous verrez qu'il n'y a pas un prince qui ne soit occupé à réformer
ses États sous les rapports sociaux, administratifs et politiques!
Tous se consacrent à cette œuvre méritoire, excepté toutefois
l'Angleterre, oui, l'Angleterre, qui, s'étant donné depuis
longtemps la liberté, s'est assuré à jamais le germe
de toutes les réformes possibles et imaginables.
Telle est l'Europe de 1875, si différente de celle de 1815, et même
de 1830! Elle était liguée, il y a quarante ans, contre les
réformes, et présentement elle est tout entière réformatrice.
Je supplie donc ceux qui croiraient se rapprocher d'elle en résistant à l'esprit
du siècle de comprendre qu'au lieu de se rapprocher d'elle, ils
s'en éloigneraient peut-être et s'attireraient, au lieu de
sympathies, des appréhensions, peut-être même du blâme.
On insiste, et l'on me dit : Oui, malgré tout ce que vous pouvez
alléguer, ces sages princes peuvent être des réformateurs,
mais ils ne sauraient être des républicains. Je me hâte
de le reconnaître, et je ne prétendrai jamais qu'il puisse
y avoir des républicains sur les trônes de Russie, d'Allemagne,
d'Autriche, d'Italie et même d'Angleterre! Mais croyez-vous donc
que ces souverains aient les yeux fermés quand vous croyez les avoir
ouverts? Vous n'aimez pas la république, et plusieurs d'entre vous
l'ont votée par raison, par patriotisme. Eh bien, croyez-vous que
tout ce que vous savez, l'Europe ne le sache pas, que les raisons qui vous
ont décidés ne lui soient pas connues ? Non, non, elle sait
qu'il n'y avait de possible que ce que vous avez fait, et vous approuve
de l'avoir fait. Elle sourit quand on lui prête telle ou telle préférence.
Elle n'a ni amour ni haine ; elle a le souci du repos du monde ; elle y
tient par intérêt, par humanité, par hauteur de vues,
et il y a tel changement que vous supposez devoir lui être agréable,
qu'elle verrait avec grande inquiétude, parce qu'elle ne le croirait
ni sensé ni durable.
Quant à la France, l'Europe l'estime, s'intéresse à elle,
souhaite son rétablissement, car elle sent la France indispensable à l'équilibre
européen. En voulez-vous une preuve? Ce printemps, un trouble de
cause inconnue s'est produit dans les esprits, des craintes de guerre ont
envahi toutes les imaginations, et alors l'Europe s'est-elle montrée
hostile ou indifférente à la France? Loin de là !
Un cri de paix est parti de tous les cabinets, et la paix a été maintenue
par la puissance du sentiment universel. On parle d'alliance : n'est-ce
pas là de la véritable, de la solide alliance, et la seule
possible dans l'état présent des choses ? Sans doute, si,
par alliance, on entend le concert de deux ou trois puissances unies pour
atteindre un but particulier, spécial, intéressé,
oh! sans doute, la France n'en a pas ; et, voulez-vous que je vous le dise,
je n'en connais aucune de semblable en Europe aujourd'hui. A ce titre,
personne, dans le temps présent, n'est l'allié d'un autre
; mais tout le monde est l'allié de tout le monde, pour le maintien
du repos des nations; et cette alliance vraiment sainte comprend, protège
tous les intérêts, et, pour longtemps encore, est la seule
souhaitable, la seule possible.
Je résume, Messieurs, ces réflexions, peut-être trop
longues, mais que votre présence, que les souvenirs que vous me
rappelez, ont fait jaillir de mon esprit et de mon cœur, et je vous
dis :
Le destin, c'est-à-dire un long enchaînement des choses, où il
entre des fautes qu'il ne faut plus rappeler, le destin a prononce. Personne,
depuis cinq ans, n'a pu rétablir la monarchie, et l'Assemblée
nationale, quoique monarchique, a voté la république. Soyons
conséquents, et tâchons de faire de cette république
un gouvernement régulier, sage, fécond, et pour cela demandons à la
France, par les élections futures, d'imprimer au gouvernement l'unité de
vues dont il a indispensablement besoin.
Prions surtout cette chère et noble France de ne pas laisser rabaisser,
insulter, l'immortelle Révolution de Quatre-vingt-neuf, contre laquelle
tant d'efforts sont dirigés aujourd'hui, et qui est notre gloire
la plus pure et la plus populaire chez les nations ; car c'est elle qui,
depuis trois quarts de siècle, a fait pénétrer la
justice dans la législation de tous les peuples. Lorsque, en effet,
les blancs étaient affranchis en Europe par la main d'un sage et
généreux prince, lorsqu'on Amérique les noirs voyaient
leurs fers brisés par la main d'une grande nation, c'est que l'esprit
de Quatre-vingt-neuf avait soufflé sur ces régions si lointaines.
Certes nous avions atteint le comble de la gloire militaire, et cette gloire,
un instant éclipsée, ne périra point ; mais, si la
gloire militaire est un soleil qui se voile quelquefois de nuages, la gloire
de la civilisation est un soleil qui ne cesse jamais de resplendir. C'est
elle, et j'ai pu le voir chez les nations étrangères, c'est
elle qui, toujours restée éclatante, même au moment
de nos plus grands revers, avait réveillé en notre faveur
la sympathie de toutes les nations, même les moins bien disposées
pour nous. Unissons-nous donc pour conserver celle noble partie du patrimoine
national, et, en ce qui me concerne, elle aura toujours pour la défendre
les derniers efforts d'une vie qui tend à sa fin, mais qui, jusqu'à son
dernier jour, restera fidèle à tous les grands intérêts
de la raison et de l'humanité.

source : Bibliothèque
nationale de France
Université de
Chicago (extraordinaire collection de Photos)
L'histoire
par l'image
6/01/14
















